Gérard Dastugue
Quincy Jones, compositeur d'écran (EUD, 2025).
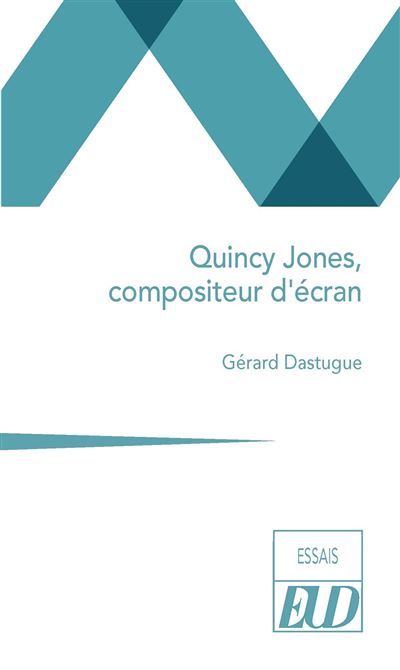
Une décennie consacrée à des musiques pour l'écran, en plus de ses propres albums et autres travaux, c'est peu et beaucoup à la fois dans l'immense carrière de Quincy Jones. Trompettiste, compositeur, arrangeur, producteur et passeur de frontières, il se fit surnommer « Q » ( à prononcer « Kiou »), par Frank Sinatra. Il fut le producteur, confident, catalyseur de Michael Jackson pour Off The Wall, Thriller et Bad, trilogie qui a battu tous les records. « Q » est un précipité alpha-chimique de l'histoire des musiques populaires.
Bien avant les strass, les Grammies et la gloire planétaire, il y a eu les repas constitués de rats frits en période de Dépression économique à Chicago dans les années 30. Il y a eu sa volonté d'être, sa volonté d'être compositeur et musicien. Un itinéraire de vie envisagé face à un vieux piano, à ses 11 ans, comblant son vide intérieur engendré par une mère absente, internée pour cause de schizophrénie. Son appétence pour la trompette le poussant à prendre des leçons tard dans la nuit auprès d'un maître jouant dans des tripots. Son appétence le poussant à fréquenter Count Basie et Ray Charles dans les années 40. Son appétence le poussant à se rapprocher du Big Band de Lionel Hampton à la fin de cette décennie et à l'intégrer au début des années 1950. L'ouvrage fait bien plus que relater le « Quincy Jones, compositeur d'écran ». En 100 pages tout rond, annexes comprises, Gérard Dastugue narre l'ensemble de la biographie de « Q ».
Le point de bascule a lieu en Europe plutôt qu'aux Etats-Unis, entre la fin des années cinquante et le début des années soixante, alors que « La maîtrise des cordes (...) se construit donc pour Jones dans l'improbable mariage entre l'académique [ Nadia ] Boulanger et le divertissement de [Eddie et Nicole] Barclay » (page 24). Et puis il y a Michel Legrand, pour Lola (1961), pour lequel Quincy Jones met en contact Michel Legrand avec Jacques Demy pour son premier film ! Quincy Jones est d'ores et déjà un catalyseur des plus belles pages de l'histoire des musiques de films, en France, sans sa présence. Quelques pages plus loin, en 1964 à New York, Quincy Jones est nommé directeur artistique de Mercury Records : « Il devient le premier afro-américain à accéder à un tel poste au sein d'un label » (page 28). Puis vice-président de Mercury Records. Bien avant Thriller, Quincy Jones joue les passeurs de frontières, il remet en cause les limites dans lesquelles les Afro-américains sont censés se cantonner.
La partie la plus longue de l'ouvrage retrace la décennie où Quincy Jones a composé plus d'une quarantaine de partitions pour le cinéma et la télévision. Elle est titrée : « Les compositeurs ne dorment pas la nuit (1962-1972)», ce qui révèle déjà l'intense activité de « Q » en ces années. Elle démarre dès 1961 avec la composition de la B.O. du Prêteur sur gages de Sidney Lumet, avec Rod Steiger dans le rôle principal. Quincy Jones attend cependant 1965, et le soutien de Henry Mancini, pour être engagé sur Mirage de Edward Dmytryck. Quincy Jones obtient une première nomination aux Oscars pour la chanson « The Eyes Of Love » écrite pour Banning en 1967. Il participe au chef-d'oeuvre In The Heat Of The Night (Dans La Chaleur de la Nuit) de Norman Jewison en 1968, film brûlot dans le contexte de lutte pour les Droits civiques. Le film est porté à la fois par Sidney Poitiers et par la musique. Séquence marquante, Sidney Poitiers, dans son rôle de policier noir, gifle un patron d'une bourgade sudiste. La musique, sublime, est faite de compositions originales et de chansons entendues à la radio. Gérard Dastugue parle de source music : la source de la musique apparaît à l'écran. Quincy Jones écrit sa premier partition pour la télévision pour la série Hey landlord en 1966. Il signe une autre musique de référence dans sa carrière avec le générique de la série Ironside (L'Homme de Fer) en 1967. Il écrit le générique du Bill Cosby Show (1969). Quincy Jones casse la routine du générique : « Pour The new Cosby Show (1972-1973), il propose que le générique de chaque épisode offre une improvisation autour du thème musical, en invitant de grands musiciens (...)» (page 51), parmi lesquels McCoy Tyner, Jimmy Smith, Roland Kirk...
La décennie 1962-1972 concentre la majorité des musiques de Quincy Jones pour l'écran, mais il en a composées avant et après, de Le garçon dans l'arbre en 1961, à La Couleur Pourpre en 1985, en passant par The Wiz (with Michael Jackson) en 1978. Gérard Dastugue est allé chercher, comme il l'annonce en introduction, la Quintessence de Quincy Jones (titre d'un album de 1961), par le prisme du cinéma. Le film La Couleur Pourpre de Steven Spielberg est onze fois nominés aux Oscars, mais il n'en obtient aucun. Il n'obtient pas celui de la "meilleure musique de film", probablement parce que Quincy Jones est attaché à préciser l'apport de chacun, et a crédité dix-huit personnes à l'élaboration de cette bande originale. La liste est réduite à douze pour tenter de satisfaire l'Académie des Oscars. En vain, c'est la musique de John Barry, pour le film de Out Of Africa de Sydney Pollack, qui l'obtient.
Gérard Dastugue offre un texte d'une grande densité. Il documente, cite, étaye le propos d'analyses minutieuses de l'apport des musiques de Quincy Jones aux films, amenant aussi une réflexion sur la place de « Q » dans l'évolution de l'histoire de cet art, et dans l'évolution des musiques populaires tout court.
