éthiopiques
Retour sur la fabuleuse collection Éthiopiques, du groove comme s'il en pleuvait (30 volumes), depuis la redécouverte de l'éthio-jazz de Mahmoud Ahmed (« Era Mèla Mèla ») par Francis Falceto, en passant par « Yèkèrmo Sèw » de Mulatu Astatqé utilisé dans Broken Flowers de Jim Jarmusch.
Vol. 24 : L'âge d'or de la musique éthiopienne moderne 1969-1975
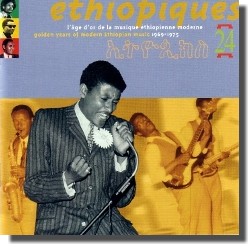
Voici les 24e et 25e volumes de la collection éthiopiques dédiée à faire ressurgir du passé les enregistrements de l'âge d'or de la musique éthiopienne moderne, qui s'étale de 1969 à 1978. Son groove urbain est si unique et entraînant que l'on a peine à croire que ces enregistrements aient pu rester si longtemps à prendre la poussière au fin fond d'une cave grecque.
Francis Falceto avait découvert le désormais célèbre « Era Mèla Mèla » de Mahmoud Ahmed au début des années quatre-vingt et le fit reparaître sur l'iconoclaste label belge Crammed Discs en 1987. Il lui aura donc fallu une bonne dizaine d'années supplémentaires de démarches passionnées, de voyages, de rencontres, et la découverte de ladite cave grecque, pour lancer les éthiopiques chez Buda Musique. Dans cette collection, a été à nouveau réédité l'album Era Mèla Mèla de Mahmoud Ahmed, le volume 7.
Depuis l'aventure se prolonge patiemment, car il faut de la persévérance pour confectionner ces disques d'une très bonne qualité sonore accompagnés de livrets toujours très documentés. Notons simplement, pour les précédents volumes, que ceux qui auraient découvert l'éthio-groove à travers Broken Flowers sans en connaître l'origine doivent se précipiter sur le volume 4 : éthio-jazz & musique instrumentale 1969-1974, consacré à Mulatu Astatqé. Il contient plusieurs titres utilisés dans la bande son du film de Jim Jarmusch, notamment le désormais fameux aussi « Yèkèrmo Sèw » composé par Mulatu Astatqé. Bill Murray écoute ce titre grâce à un ami, qui lui a gravé une compilation sur CD-R.
Le volume 24 continue l'exploration de l'âge d'or de la musique éthiopienne. Il nous donne à découvrir plusieurs titres des chanteurs Sèfou Yohannes, Ayaléw Mesfin, Wubshèt Fisseha ou encore Mulatu Astatqé. Ce groove, c'est un mouvement très marqué de balancier proche de celui du rhythm and blues accompagné d'une guitare électrique et fréquemment appuyé et relancé par une section de cuivres pour propulser des textes chantés le plus souvent en amharique, l'une des marques si particulières du « swinging Addis ». Si l'on veut situer cet indéfinissable groove, c'est finalement du côté de la Jamaïque et du Rock Steady, qui précède de peu le reggae, que l'on trouve un genre un tant soit peu comparable. Et sans que cela soit lié aux Rastafaris eux-mêmes, qui pourtant vénéraient l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié.
Cet « éthio-groove » peut se jouer sur le mode slow, mais est le plus souvent sur un mode plutôt rapide, voire prenant brusquement de la vitesse. Petites surprises, en fin de volume, déboule « Assiyo bélléma » aux rythmes caribéens soutenus par des steel drums, puis des titres totalement soul-funk, ceux des Ashantis, en anglais. On retrouve sur ce volume 24 une autre version de « Yèkèrmo Sèw », cette fois-ci chantée par Sèyfou Yohannes.
Vol. 25 : 1971-1975 Modern Roots
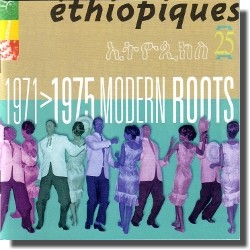
Le volume 25 1971 > 1975 Modern Roots met l'accent sur les traditions amhara et oromo, les deux grands ensembles culturels et linguistiques d'Éthiopie. Les chanteurs Thahoun Gèssèssè, Essatu Tèssèmma, Sèfou Yohannes, Abaynèh Dèdjèné et quelques autres reprennent des airs traditionnels et nous plongent dans un univers sonore plus acoustique, plus simplement habillé de flûte, tambourin, d'instruments à cordes et de claquements de mains, de choeurs répondant au chanteur soliste. Sur certains titres viennent poindre à nouveau des sonorités plus modernes d'orgues et de cuivres.
Au moment de la première écriture de cette page, vers 2008, l'entreprise titanesque, mais salutaire, de Francis Falceto était de continuer de rééditer l'intégralité des quelques cinq-cents 45 tours simple et trente 33 tours qui constituent la production discographique éthiopienne des années 1969-1978. La quasi intégralité du label phare de cette époque, Amha Records, était alors rééditée. Il restait encore quelques volumes des éthiopiques à venir, consacrés à d'autres labels, en particulier à Kaifa Records. Elle compte désormais 30 volumes.
- www.budamusique.com/.../ethiopiques-30
- Un siècle de musique moderne en Éthiopie (précédé de Une hypothèse baroque) Francis Falceto in Cahiers d'études africaines n°168 (2002) : Musiques du monde
